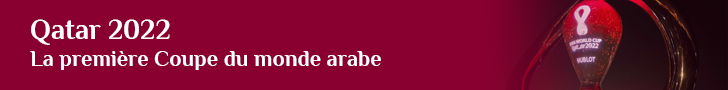Les États-Unis sont-ils à l’aube d’une guerre contre l’Iran ? Le président américain Donald Trump a fait savoir vendredi qu’il allait envoyer 1 500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes avec la République islamique. « Nous allons envoyer un nombre relativement faible de troupes, pour la plupart préventives, et certaines personnes très talentueuses se rendent au Moyen-Orient en ce moment », a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche. « Ce sera environ 1 500 personnes. »
Dans un communiqué, le secrétaire à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a précisé que l’envoi de ces forces visait à « améliorer la protection et la sécurité des forces américaines, compte tenu de menaces persistantes de la part de l’Iran, y compris des Gardiens de la révolution et de leurs soutiens », autrement dit l’armée d’élite de la République islamique et les milices chiites qui lui sont inféodées dans la région. Ce déploiement américain inclut un bataillon de 600 hommes chargés de quatre batteries antimissiles Patriot qui se trouve déjà dans la région, portant le nombre de renforts effectivement envoyés à 900, a indiqué l’amiral Michael Gilday, un responsable de l’état-major américain, selon l’Agence France-Presse (AFP). Les effectifs devraient être envoyés dans les bases dont disposent déjà les États-Unis au Moyen-Orient, mais pas en Irak ni en Syrie, a précisé le Pentagone. Des appareils de reconnaissance et de surveillance et un escadron de 12 avions de chasse devraient compléter le dispositif
après les derniers chiffres délivrés par le Pentagone, les États-Unis disposeraient aujourd’hui de 70 000 soldats dans la zone couverte par le Centcom, dont 14 000 en Afghanistan, 5 000 en Irak, et moins de 2 000 en Syrie. Interrogé par Le Point, Hamzeh Safavi, professeur de sciences politiques à l’université de Téhéran, rejette l’idée d’un conflit imminent. « Le nombre relativement peu élevé de soldats envoyés dans la région n’est pas de nature à changer la donne vis-à-vis de l’Iran », estime l’expert, également directeur de l’Institut pour les études futures du monde islamique (IIWFS). « Le seul risque est celui d’incidents isolés. » En l’absence de canal de communication désormais entre les deux camps, Gardiens de la révolution et soldats américains, qui se côtoient chaque jour en Irak, en Syrie et dans les eaux du golfe Persique, ne sont plus à l’abri d’accrochages.
La décision de Donald Trump est d’autant plus surprenante que le milliardaire américain avait milité durant la campagne présidentielle pour « mettre fin aux guerres interminables » dans le monde, et de joindre le geste à la parole en entamant un retrait des troupes américaines en Syrie et en Afghanistan en décembre dernier. Une stratégie qu’avait publiquement regrettée le général Kenneth McKenzie, commandant du Centcom. « Nous n’avons pas les effectifs suffisants pour être où nous voulons être en nombre adéquat, partout, tout le temps », avait-il souligné lors d’une conférence organisée ce mois-ci.
Le revirement américain semble avoir été motivé par la révélation, le 3 mai, de « nouveaux renseignements inquiétants » faisant état d’une aggravation de la menace iranienne, notamment des « attaques imminentes » contre les intérêts et soldats américains au Moyen-Orient. D’après le New York Times, ce rapport, qui comprend notamment des interceptions téléphoniques et des imageries satellites, indiquerait que Téhéran a ordonné à ses milices en Irak de se préparer à attaquer les forces américaines. En outre, les photographies obtenues par les Américains montreraient que des Gardiens de la révolution, l’armée d’élite de l’Iran, ont chargé des missiles à bord de boutres naviguant dans le golfe Persique pour attaquer des embarcations militaires et commerciales américaines.
Ces nouveaux éléments ont été déterminants dans la décision américaine d’envoyer le 5 mai dans le Golfe le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, le navire de guerre USS Arlington, une force de bombardiers B-52, ainsi qu’une batterie de missiles Patriot. Or, une semaine plus tard, deux attaques ont visé l’Arabie saoudite, principal allié arabe des États-Unis dans la région et farouche adversaire de la République islamique d’Iran. Le 12 mai, Riyad a dénoncé, photo à l’appui, des « actes de sabotage » contre quatre navires, dont trois pétroliers (deux saoudiens et un norvégien), au large du port émirien de Fujairah. Si les dégâts se sont avérés minimes et que l’attaque n’a pas été revendiquée, les soupçons se sont dirigés vers Téhéran, suspecté d’avoir voulu envoyer un « message » à Washington.
Deux jours plus tard, le royaume Al Saoud a annoncé que deux stations de pompage d’un oléoduc majeur reliant l’est à l’ouest du pays avaient été endommagées après avoir été visées par des attaques de sept « drones armés ». Cette fois, celles-ci ont été revendiquées par les rebelles yéménites houthis, soutenus par l’Iran, que l’Arabie saoudite accuse d’avoir commandité l’attaque. Mardi, pour la première fois, le secrétaire d’État Mike Pompeo a estimé « assez probable que l’Iran soit derrière » ces sabotages. Considéré comme un faucon, opposé de longue date à la République islamique d’Iran, le chef de la diplomatie américaine a déclaré baser ses allégations sur « la forme de ces attaques », et sur « tous les conflits régionaux de la dernière décennie ».
Cette soudaine recrudescence des tensions au Moyen-Orient a suscité de nombreuses interrogations auprès des élus du Congrès, certains sénateurs démocrates rappelant les « mensonges » sur les armes de destruction massive qui ont poussé les Américains à intervenir en Irak en 2003. Pour lever leurs doutes, le secrétaire américain à la Défense et le secrétaire d’État ont organisé mardi une réunion à huis clos avec les parlementaires américains. « Il s’agit de faire de la dissuasion, pas la guerre », a assuré, à l’issue de la rencontre, le chef du Pentagone Patrick Shanahan, précisant que les dispositions prises par Washington avaient permis d’« éviter des attaques » contre « les forces américaines » dans la région.
En effet, d’après le New York Times, les Gardiens de la révolution auraient retiré la semaine dernière plusieurs missiles de leurs boutres en signe d’apaisement. Toutefois, les responsables américains n’ont pas révélé aux sénateurs les fameux « nouveaux renseignements inquiétants » à l’origine des tensions actuelles. Selon des responsables militaires américains, cités par l’AFP, le Pentagone subirait en réalité les conséquences de la politique de « pression maximale » menée par Donald Trump vis-à-vis de l’Iran.
« Pas besoin d’eux » (Donald Trump)
Après le retrait américain unilatéral de l’accord sur le nucléaire iranien en mai 2018, pourtant conclu avec cinq autres « grandes puissances » (Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), le président américain a prononcé deux salves de sanctions drastiques contre le système bancaire et le pétrole iranien en août et novembre 2018. Le 8 avril dernier, le pensionnaire de la Maison-Blanche est allé encore plus loin en désignant comme « organisation terroriste » les Gardiens de la révolution, une première pour un corps armé appartenant à un État. « C’est après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire et les menaces des États-Unis que l’Iran a élevé le niveau d’alerte de ses forces de sécurité », affirme le spécialiste Hamzeh Safavi. « Et l’envoi de soldats américains ne va que renforcer la détermination de Téhéran à résister à la stratégie de pression américaine par la pression. L’Iran n’a de toute façon pas d’autre choix ». Le 8 mai dernier, Téhéran a annoncé qu’il renonçait à limiter ses stocks d’uranium enrichi et d’eau lourde, comme il s’y était pourtant engagé en vertu de l’accord sur le nucléaire.
Hasard du calendrier, ce même vendredi soir, l’administration Trump a informé le Congrès qu’elle avait autorisé la conclusion de nouveaux contrats d’armement avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en outrepassant le blocage des parlementaires américains en raison de leur probable utilisation dans la désastreuse guerre au Yémen. À en croire le Secrétaire d’État, Mike Pompeo, ces armes, d’un montant de 8,1 milliards de dollars (elles concernent également la Jordanie, NDLR) vont « renforcer la stabilité du Moyen-Orient et aider ces nations à faire de la dissuasion et à se défendre de la République islamique d’Iran ».